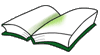| Titre : |
Le bÃĐton gÃĐopolymÃĻre : ÃĐtat de lâart, analyse thÃĐorique et pratique et applications en gÃĐnie civil |
| Type de document : |
Travail de fin d'ÃĐtudes |
| Auteurs : |
Antoine VANCOILLE, Auteur ; Morgan LAITAT, ; Yves Gobert, |
| Editeur : |
ECAM |
| AnnÃĐe de publication : |
2024 |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clÃĐs : |
MatÃĐriaux de construction |
| Index. dÃĐcimale : |
TFE - Construction |
| RÃĐsumÃĐ : |
Les gaz à effet de serre sont la principale cause du dÃĐrÃĻglement climatique, qu'il faut à tout prix limiter tant ses consÃĐquences pourraient Être dramatiques pour l'Être humain et, de maniÃĻre plus gÃĐnÃĐrale, pour notre planÃĻte. Le bÃĐton est responsable, à lui seul, d'environ 8 % de ces ÃĐmissions, dont la grande majoritÃĐ provient de la production de ciment : un liant nÃĐcessitant de grandes ressources ÃĐnergÃĐtiques pour atteindre sa forme finale, puisque sa fabrication se fait en portant les matiÃĻres premiÃĻres à de trÃĻs hautes tempÃĐratures, et cela en utilisant des combustibles fossiles. Pour pallier ces importantes ÃĐmissions de gaz à effet de serre, de nombreux chercheurs se sont lancÃĐs dans la recherche de solutions dites ÂŦ bas carbone Âŧ. Parmi elles, le bÃĐton gÃĐopolymÃĻre. Le terme gÃĐopolymÃĻre, introduit dans les annÃĐes 70 par le Professeur Joseph Davidovits, fait rÃĐfÃĐrence à un matÃĐriau inorganique. Pour un bÃĐton ÃĐponyme, le liant est alors remplacÃĐ par un matÃĐriau gÃĐopolymÃĻre. Cette solution peut Être caractÃĐrisÃĐe comme ÃĐcologique pour deux raisons principales. PremiÃĻrement, les matiÃĻres premiÃĻres les plus frÃĐquemment utilisÃĐes sont ce que l'on appelle des ÂŦ dÃĐchets de l'industrie Âŧ, tels que les cendres volantes et le laitier de haut fourneau. DeuxiÃĻmement, le processus de fabrication nÃĐcessite moins d'ÃĐnergie puisque les matÃĐriaux sont activÃĐs à des tempÃĐratures basses (60-90 °C). Ce travail de fin d'ÃĐtudes a pour but de rÃĐpondre à une question bien prÃĐcise : le bÃĐton gÃĐopolymÃĻre peut-il remplacer le bÃĐton de ciment dans le domaine du gÃĐnie civil ? Pour ce faire, le travail a pour objectif de comparer les propriÃĐtÃĐs mÃĐcaniques du matÃĐriau telles que les rÃĐsistances à la compression, à la traction, etc., mais aussi le comportement du bÃĐton dans des environnements agressifs, rÃĐguliers pour les ouvrages d'art. Par la suite, les aspects ÃĐcologiques et ÃĐconomiques du matÃĐriau sont traitÃĐs, avant d'ÃĐtudier ses aspects plus pratiques dans le gÃĐnie civil : mÃĐthodologies de dimensionnement et de mise en Åuvre. LâÃĐtude de quelques cas pratiques permettra la synthÃĻse critique des expÃĐrimentations dÃĐjà rÃĐalisÃĐes. |
Le bÃĐton gÃĐopolymÃĻre : ÃĐtat de lâart, analyse thÃĐorique et pratique et applications en gÃĐnie civil [Travail de fin d'ÃĐtudes] / Antoine VANCOILLE, Auteur ; Morgan LAITAT, ; Yves Gobert, . - ECAM, 2024. Langues : Français ( fre)
| Mots-clÃĐs : |
MatÃĐriaux de construction |
| Index. dÃĐcimale : |
TFE - Construction |
| RÃĐsumÃĐ : |
Les gaz à effet de serre sont la principale cause du dÃĐrÃĻglement climatique, qu'il faut à tout prix limiter tant ses consÃĐquences pourraient Être dramatiques pour l'Être humain et, de maniÃĻre plus gÃĐnÃĐrale, pour notre planÃĻte. Le bÃĐton est responsable, à lui seul, d'environ 8 % de ces ÃĐmissions, dont la grande majoritÃĐ provient de la production de ciment : un liant nÃĐcessitant de grandes ressources ÃĐnergÃĐtiques pour atteindre sa forme finale, puisque sa fabrication se fait en portant les matiÃĻres premiÃĻres à de trÃĻs hautes tempÃĐratures, et cela en utilisant des combustibles fossiles. Pour pallier ces importantes ÃĐmissions de gaz à effet de serre, de nombreux chercheurs se sont lancÃĐs dans la recherche de solutions dites ÂŦ bas carbone Âŧ. Parmi elles, le bÃĐton gÃĐopolymÃĻre. Le terme gÃĐopolymÃĻre, introduit dans les annÃĐes 70 par le Professeur Joseph Davidovits, fait rÃĐfÃĐrence à un matÃĐriau inorganique. Pour un bÃĐton ÃĐponyme, le liant est alors remplacÃĐ par un matÃĐriau gÃĐopolymÃĻre. Cette solution peut Être caractÃĐrisÃĐe comme ÃĐcologique pour deux raisons principales. PremiÃĻrement, les matiÃĻres premiÃĻres les plus frÃĐquemment utilisÃĐes sont ce que l'on appelle des ÂŦ dÃĐchets de l'industrie Âŧ, tels que les cendres volantes et le laitier de haut fourneau. DeuxiÃĻmement, le processus de fabrication nÃĐcessite moins d'ÃĐnergie puisque les matÃĐriaux sont activÃĐs à des tempÃĐratures basses (60-90 °C). Ce travail de fin d'ÃĐtudes a pour but de rÃĐpondre à une question bien prÃĐcise : le bÃĐton gÃĐopolymÃĻre peut-il remplacer le bÃĐton de ciment dans le domaine du gÃĐnie civil ? Pour ce faire, le travail a pour objectif de comparer les propriÃĐtÃĐs mÃĐcaniques du matÃĐriau telles que les rÃĐsistances à la compression, à la traction, etc., mais aussi le comportement du bÃĐton dans des environnements agressifs, rÃĐguliers pour les ouvrages d'art. Par la suite, les aspects ÃĐcologiques et ÃĐconomiques du matÃĐriau sont traitÃĐs, avant d'ÃĐtudier ses aspects plus pratiques dans le gÃĐnie civil : mÃĐthodologies de dimensionnement et de mise en Åuvre. LâÃĐtude de quelques cas pratiques permettra la synthÃĻse critique des expÃĐrimentations dÃĐjà rÃĐalisÃĐes. |
|  |


 Visionner les documents numÃĐriques
Affiner la recherche
Visionner les documents numÃĐriques
Affiner la rechercheLe bÃĐton gÃĐopolymÃĻre : ÃĐtat de lâart, analyse thÃĐorique et pratique et applications en gÃĐnie civil / Antoine VANCOILLE

 Ce document n'est visible qu'aprÃĻs identification
Ce document n'est visible qu'aprÃĻs identification